Calendrier des soutenances de thèse
Soutenance de thèse
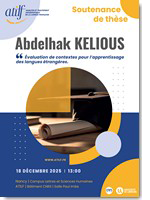
Évaluation de contextes pour l’apprentissage des langues étrangères.
Abdelhak Kelious
18 décembre 2025 | 13:00
Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | ATILF | Bâtiment CNRS | Salle Paul Imbs
Membres du jury
Davide BUSCALDI (MCF HDR, Univ. Sorbonne Paris-Nord) | Rapporteur
Iris ESHKOL TARAVELLA (PR, Université Paris Nanterre) | Rapporteure
Natalia GRABAR (CR, CNRS, Univ. Lille) | Examinatrice
Alex BOULTON (PR, UL) | Examinateur
Mathieu CONSTANT (PR, UL) | Directeur de thèse
Résumé de la thèse
Il existe de nombreuses plateformes en ligne destinées à l’apprentissage des langues étrangères, dont certaines ont l’ambition de suivre l’élève dans sa progression et de personnaliser son apprentissage. Cependant, l’un des challenges majeurs reste de réussir à motiver l’élève sur le long terme. Les apprenants modernes utilisent de plus en plus les réseaux sociaux et les vidéos pour se divertir et accéder à l’information. Ils sont demandeurs d’outils d’apprentissage moins théoriques et accessibles instantanément sur leur smartphone. Les vidéos contribuent à motiver les apprenants tout en leur transmettant la culture du pays de la langue apprise. Dans notre cas, l’objectif serait de concevoir un algorithme amélioré de récupération de vidéos afin de proposer automatiquement à l’élève les contextes les plus pertinents pour lui, selon divers critères tels que son niveau courant dans la langue étudiée, le niveau qu’il souhaite atteindre, ses centres d’intérêt. On prendra également en compte son historique.Le but est de motiver l’élève en lui fournissant du contenu qui va lui correspondre, qui va l’aider à progresser. Nous nous limiterons à l’anglais et au français. L’objectif de cette thèse est d’évaluer si les méthodes neuronales d’apprentissage automatique permettent de récupérer les meilleurs contextes d’apprentissage pour un élève soit de manière statique (i.e. on vise un niveau dans l’absolu), soit de manière dynamique (i.e. on sélectionne les contextes dynamiquement en fonction de l’historique de l’élève sur l’application). Dans le deuxième cas de figure, nous proposons de mettre en place une architecture neuronale s’appuyant sur un apprentissage par renforcement, s’inspirant des systèmes de dialogue.
Actualité de novembre 2025
Soutenance de thèse
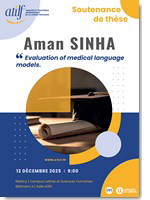
Evaluation of medical language models.
Aman Sinha
12 décembre 2025 | 09:00
Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | Bâtiment A | Salle A351
Membres du jury
Lucie Flek, University of Bonn, Germany
Douglas Teodoro, University of Geneva, Switzerland
Aurélie Névéol, Université Paris-Saclay, France
Maxime Amblard, Université de Lorraine, France
Eric de la Clergerie, INRIA, France
Direction et codirection de la thèse
Marianne Clausel, Université de Lorraine | Directrice
Mathieu Constant, ATILF, Université de Lorraine – CNRS | Co-directeur
Xavier Coubez, ICANS Strasbourg | Co-directeur
Title of the thesis / Titre de la thèse
Evaluation of medical language models / Évaluation des modèles de langue médicaux
Abstract of the thesis / Résumé de la thèse
Medical language is complex and very different from everyday language: it contains many specialized terms, abbreviations, and unstructured notes that are often difficult for computers to understand. This makes the application of artificial intelligence (AI) systems, which are usually trained on general texts such as news articles or web pages, particularly difficult in the medical field.
This thesis seeks to understand why current language models struggle to process medical data and how they can be improved, especially for social media posts, clinical records, and scientific literature, each with its own linguistic and structural characteristics.
*****************************************
Le langage médical est complexe et très différent du langage courant : il contient de nombreux termes spécialisés, abréviations et notes non structurées, souvent difficiles à comprendre pour les ordinateurs. Cela rend l’application des systèmes d’intelligence artificielle (IA), généralement entraînés sur des textes généraux comme les articles de presse ou les pages web, particulièrement difficile dans le domaine médical.
Cette thèse cherche à comprendre pourquoi les modèles de langage actuels ont du mal à traiter les données médicales et comment ils peuvent être améliorés, notamment pour les publications dans les réseaux sociaux, les dossiers cliniques et la littérature scientifique, chacun présentant des caractéristiques linguistiques et structurelles propres.
Actualité de décembre 2025
Soutenance de thèse

Vers une didactique de l’interaction : l’apprentissage avec et sur corpus au service du développement de la compétence interactionnelle en FLE.
Clara Cousinard
21 novembre 2025 | 14:00
Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | ATILF | Bâtiment CNRS | Salle Paul Imbs
Membres du jury
Virginie ANDRÉ, Université de Lorraine | Directrice de thèse
Isabelle RACINE, Université de Genève | Rapporteure
Henry TYNE, Université de Perpignan Via Domitia | Rapporteur
Karmele ALBERDI, Univeristé de Grenade | Examinatrice
Alex BOULTON, Université de Lorraine | Examinateur
Mots-clés
Français Langue Etrangère, compétence interactionnelle, apprentissage sur corpus, apprentissage sur corpus, stratégies d’apprentissage, français parlé en interaction
Résumé de la thèse
Cette thèse s’inscrit à l’interface entre la linguistique et la didactique des langues. Plus précisément, elle propose de faire des liens entre la linguistique de corpus et la didactique de l’oral en Français Langue Étrangère (FLE). Les recherches actuelles dans ce domaine s’accordent pour soutenir que l’exposition à la langue cible pour des apprenants est indispensable. L’exploitation de corpus oraux et multimodaux authentiques pour enseigner et apprendre à interagir fait actuellement partie des méthodologies didactiques qui sont expérimentées par de nombreux enseignants et apprenants de FLE selon différentes modalités (Ravazzolo, Etienne 2019 ; Etienne, Jouin 2019 ; André 2019, 2018). Il existe plusieurs façons d’exploiter des corpus à des fins didactiques et plusieurs types de corpus peuvent faire l’objet de séquences pédagogiques en FLE (André 2019). Cette confrontation des apprenants à des corpus en langue cible s’inscrit dans le prolongement de l’utilisation de documents authentiques en didactique (Holec 1990 ; Boulton 2009). Depuis les années 1970, de nouvelles formes d’exposition sont apparues notamment avec les progrès technologiques et l’accès au numérique.
La thèse s’intéressera à l’exploitation des corpus à des fins didactiques selon les principes du data-driven learning (Johns 1991, Aston 2001), traduit en français par l’apprentissage sur corpus (ASC) (Boulton, Tyne 2014), et de l’apprentissage avec corpus (AAC) dans l’optique de développer la compétence interactionnelle des apprenants. Les études menées jusqu’à présent révèlent que l’ASC permet aux enseignants et aux apprenants d’aborder la langue d’une façon novatrice. La question de la compétence interactionnelle est, elle, peu abordée en didactique du FLE. Les apprenants posent alors des questions auxquelles les enseignants ne savent pas ou ne veulent pas répondre, notamment parce que les descriptions du français parlé en interaction sont peu référencées dans les manuels et les grammaires (voir par exemple Blanche-Beneviste, Jeanjean 1987 ; Mondada 2002 ; Kerbrat-Orecchioni 2005 ; Traverso 2016 ; Giroud, Surcouf 2016). Ces questions sont pourtant légitimes et peuvent être traitées conjointement avec l’ASC et l’AAC qui permettent de développer un comportement d’apprentissage plus efficace que la grammaire explicite, celle qui est prescrite par l’enseignant (Lin 2019, Liu 2011, Miangah 2011). Nous mettons également en lumière les stratégies d’apprentissage (Oxford 1990) mises en œuvre lors des séances d’ASC et d’AAC, qui permettent un développement de la conscience langagière des apprenants et, à terme, de la compétence interactionnelle des apprenants. Nous traitons quatre questions de recherche : (1) Comment les apprenants manipulent-ils les données de corpus ? ; (2) Quelles composantes de la compétence interactionnelle les apprenants travaillent-ils ? ; (3) Quelles sont les stratégies d’apprentissage mises en œuvre lors de cette manipulation des données de corpus ? ; (4) Y a-t-il corrélation entre les stratégies d’apprentissage mises en œuvre et le développement de la compétence interactionnelle ?
Actualité de novembre 2025
Soutenance de thèse
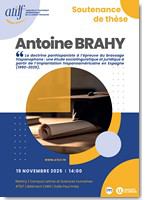
La doctrine panhispaniste à l’épreuve du brassage hispanophone : une étude sociolinguistique et juridique à partir de l’implantation hispanoaméricaine en Espagne (1990-2025).
Antoine Brahy
19 novembre 2025 | 14:00
Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | ATILF | Bâtiment CNRS | Salle Paul Imbs
Membres du jury
Anne-Marie CHABROLLE-CERRETINI, PU, Université de Lorraine, Nancy | Directrice de thèse
Sergio COTO-RIVEL, PU, Nantes Université, Nantes | Président de jury
María Carmen ALÉN GARABATO, PU, Université Paul-Valéry Montpellier 3, Montpellier | Rapporteuse
Christophe REY, PU, CY Cergy Paris Université, Cergy | Rapporteur
Tanagua BARCELÓ MARTÍNEZ, Prof.ª titular, Universidad de Málaga, Espagne | Examinatrice
Christelle DI CESARE, MCF HDR, Université de Lorraine, Nancy | Examinatrice
Olivier FOLZ, MCF, Université de Lorraine, Nancy | Examinateur
Résumé de la thèse
En abordant la thématique du panhispanisme à travers le double prisme sociolinguistique et juridique, cette thèse se situe au carrefour de différentes disciplines. L’objectif poursuivi tout au long du travail est profondément civilisationnel : il s’agit de mettre à l’épreuve du terrain une doctrine jusqu’alors purement conceptuelle, à large spectre idéologique et philosophique. Autrement dit, nous cherchons à savoir si le discours panhispaniste est parvenu, au fil des époques, à imprégner les imaginaires individuels et collectifs hispanophones. Le cas échéant, se pose la question de savoir comment se manifeste cette idéologie panhispaniste à échelle individuelle et sociétale. C’est pourquoi nous nous attachons, dans une première partie du travail de thèse, à baliser le mouvement panhispaniste tant dans sa dimension chronologique que conceptuelle. Ainsi, nous avons constaté que le discours panhispaniste délivre un message profondément identitaire et qu’il a globalement vocation à éveiller ou à renforcer chez son destinataire le sentiment d’appartenance à une communauté hispanophone supranationale.
Dans l’optique d’éprouver la portée concrète de ce discours sur la population hispanique, nous avons fondé notre recherche sur une étude de cas. Ainsi, la seconde partie de notre travail définit le contexte sociologique, linguistique et temporel à partir duquel nous avons choisi de mener l’expérience de terrain. L’Espagne des années 1990 à nos jours représente un choix judicieux dans la mesure où s’opère sur son territoire un brassage hispanophone démographiquement pertinent, puisque des milliers d’Hispanoaméricains traversent chaque année l’Atlantique pour s’établir en péninsule Ibérique.
Dans l’optique de mener à bien notre projet, nous avons misé, dans la troisième partie, sur deux approches correspondant à chacune des échelles visées. Pour interroger la dimension individuelle du panhispanisme, nous avons réalisé une enquête sociolinguistique auprès d’une échantillon de quarante-cinq migrants hispanoaméricains installés en Espagne. Ces individus ont été invités à répondre à un questionnaire élaboré par nos soins afin de recueillir leurs perceptions et attitudes linguistiques vis-à-vis des différentes variétés diatopiques de l’espagnol. Concernant les répercussions de l’idéologie panhispaniste à l’échelle collective, nous avons choisi d’analyser et de commenter un corpus de textes juridiques espagnols régissant, pour la plupart, les conditions d’octroi de la nationalité espagnole ou dont la vocation est d’encadrer l’immigration sur le territoire national. L’ensemble des informations recueillies nous permet de confronter des observations de terrain, des données empiriques, aux grandes lignes idéologiques du panhispanisme. Ce faisant, elles nous offrent la possibilité d’éprouver l’impact réel du discours panhispaniste sur la communauté hispanophone.
Actualité d'octobre 2025
Soutenance de thèse

Genre grammatical et enseignement-apprentissage du FLE en contexte turcophone : normes, résistances et émancipations.
Éléonore de Beaumont
14 novembre 2025 | 14:00
Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | ATILF | Bâtiment CNRS | Salle Paul Imbs
Membres du jury
Sophie BAILLY, Université de Lorraine | Directrice de thèse
Mariella CAUSA, Université Bordeaux Montaigne | Rapporteure
José Ignacio AGUILAR RÍO, Université Sorbonne Nouvelle | Rapporteur
Yannick CHEVALIER, Université Lumière Lyon 2 | Co-directeur de thèse
Véronique LEMOINE-BRESSON, Université de Lorraine | Examinatrice
Daniel ELMIGER, Université de Genève | Examinateur
Mots-clés
Didactique du FLE, genre, genre grammatical, turcophone, langage inclusif, recherche collaborative
Résumé de la thèse
Le genre n’étant pas grammaticalisé dans la langue turque, l’apprentissage du français par les turcophones est aussi celui d’un système bicatégorisant (masculin/féminin) et hiérarchisant (masculin > féminin). En outre, le discours grammatical sur le genre en français contribue à (re)produire des représentations autour de la primauté et de l’hégémonie du masculin. Dans ce travail de recherche, ce contexte d’apprentissage est analysé comme une situation interculturelle complexe et dynamique, qui soulève des enjeux à la fois d’acquisition de la langue cible et d’imaginaire linguistique (Houdebine, 2015), autour de la question du « sexisme » de la langue, notamment pour des apprenant·es sensibles aux discriminations de genre. Cette thèse adopte deux perspectives, pour saisir toutes les dimensions de la question. D’abord, dans ce contexte de l’enseignement-apprentissage du FLE par des apprenant·es turcophones adultes, l’enseignement de la grammaticalisation du genre en français participe-t-il à reconduire des rapports de pouvoir genrés ? Un ensemble d’analyses qualitatives et quantitatives, à travers des questionnaires et des entretiens avec des apprenant·es et des enseignant·es, mettent en lumière différentes actualisations du genre comme rapport de pouvoir, en termes d’imaginaire linguistique et d’appropriation langagière, soulevant des enjeux éthiques et politiques pour la didactique du FLE. Une deuxième question de recherche émerge alors : l’enseignement du FLE peut-il être le lieu d’une réflexion critique sur le genre, et ainsi soutenir le développement d’une conscience de genre (Perry, 2011) ? La mise en place d’une recherche collaborative avec 12 enseignant·es volontaires à l’Université Galatasaray (Istanbul) en 2021-2022 a permis de mettre au jour les freins et les leviers à la création de pédagogies émancipatrices pour l’enseignement du genre grammatical en FLE, mais aussi l’exploration de mises en œuvre concrètes autour des pratiques langagières féministes et/ou queer (le langage dit inclusif). Les conclusions de ce travail amènent à penser un ensemble de pratiques pédagogiques pour construire un enseignement critique en renforçant l’agentivité langagière et sociale des apprenant·es.
Actualité de novembre 2025
Soutenance de thèse
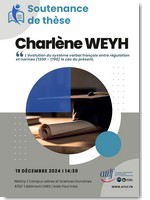
L'évolution du système verbal français, entre régularisation et norme (1300 - 1700) : le cas du présent de l'indicatif
Charlène Weyh
19 décembre 2024 | 14:30
Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | ATILF | Bâtiment CNRS | Salle Paul Imbs
Membres du jury
Sylvie Bazin-Tacchella, PR, ATILF & Université de Lorraine, Directrice de thèse
Bérengère Bouard, MCF, ATILF & Université de Lorraine, Co-directrice de thèse
Gabriella Parussa, PR, STIH & Sorbonne Université, Rapporteure
Thomas Verjans, PR, CLLE & Université de Toulouse, Rapporteur
Dan Van Raemdonck, PR, Université Libre de Bruxelles, Examinateur
Bernard Combettes, PE, ATILF & Université de Lorraine, Examinateur
Résumé de la thèse
Cette thèse en Sciences du Langage se situe dans le cadre de la morphologie verbale historique et étudie le devenir des alternances de bases au présent de l’indicatif en français. Le cadre global est celui d’une étude linguistique associant description du système verbal du français et histoire des représentations du français, et ce dans une diachronie longue, dans la mesure où certains changements sont très anciens et d’autres sont le fait de la période médiévale, tandis que d’autres datent de l’époque moderne.
Pour mener à bien cette étude, nous avons constitué un corpus de 27 verbes représentant plusieurs types d’alternances verbales, comme treuve/trouvons et aime/amons qui a donné 312 250 occurrences brutes en contexte dans Frantext de l’ancien français à 1799. Pour les verbes qui maintiennent encore des variantes verbales au 17ᵉ siècle, nous avons mené une étude métalinguistique à l’aide du Grand Corpus des grammaires françaises, des remarques et des traités sur la langue (XIVᵉ-XVIIᵉ s.) de Garnier Numérique.
Les verbes ont été regroupés selon leur alternance de départ pour une étude systématique des fréquences et autres paramètres, afin de comprendre pourquoi des verbes qui présentaient des alternances identiques en ancien français n’ont pas connu le même aboutissement en français moderne, et tenter de déterminer les facteurs favorisant le maintien de l’alternance de bases ou, au contraire, les facteurs qui favorisent l’extension d’une des deux bases verbales au présent de l’indicatif.
Finalement, de multiples paramètres ont pu jouer dans les transformations et les normalisations des paradigmes verbaux au présent de l’indicatif : la fréquence d’emploi d’une forme, d’une base ou d’un paradigme, l’appartenance d’un verbe à une famille morphologique, l’analogie intra et interparadigmatique et la prescription linguistique aux 16ᵉ et 17ᵉ siècles.
Actualité de décembre 2024
Soutenance de thèse

« Oui chef ! » Une étude ethnographique, multimodale et longitudinale de l’interaction exolingue maître-apprentie en cuisine : contribution au développement d’un logiciel d’aide à l’analyse des corpus audiovisuels annotés
Clotilde George
2 décembre 2024 | 10:30
Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | ATILF | Bâtiment CNRS | Salle Paul Imbs
Membres du jury
Ingrid De Saint-Georges, Professeure Associée, université du Luxembourg, Rapportrice
Laurent Filliettaz, Professeur des universités, université de Genève, Rapporteur
Michaël Bourgatte, Professeur des universités, université de Lorraine, Examinateur
Chantal Claudel, Professeure des universités, université Paris Nanterre, Examinatrice
Sophie Bailly, Professeure des universités, université de Lorraine, Directrice de thèse
Maud Ciekanski, Maîtresse de conférences, université de Lorraine, Co-Directrice de thèse
Résumé de la thèse
Les situations professionnelles exolingues, de plus en plus répandues, sont le lieu d’une interaction toute particulière, dont nous voudrions analyser certains ressorts. Notre recherche se fonde sur l’observation des pratiques langagières de l’interaction dans le contexte professionnel de la cuisine, entre des interactants spécifiques : le chef de cuisine français et l’apprenti étranger. Elle vise à répondre à l’interrogation : quelle forme prend l’interaction en cuisine entre deux acteurs de langues natives différentes et de statuts professionnels différents ? Pour rendre compte de l’asymétrie de cette interaction, nous nous attacherons à confronter des notions comme celles des statuts, identités et places professionnelles et langagières, observables dans les actes de langage. Dans le but de réaliser une analyse multimodale (avec pour objet la parole mais aussi les gestes, déplacements et manipulations d’objets) nous nous appuierons sur un corpus d’interactions authentiques, combinant des enregistrements vidéos, audios et prises de notes que nous collecterons par le biais d’une observation participante. Nous analyserons ce corpus avec les outils de l’analyse conversationnelle et plus précisément de l’analyse du discours, dans la perspective de la pragmatique des interactions. Nous pensons qu’il est possible d’identifier deux phénomènes distincts à l’œuvre dans l’interaction professionnelle exolingue de ce type : la réduction (surpassement des difficultés de communication par la coopération en vue de la réalisation de l’activité collective) ou l’amplification (apparition de frustration liée à un problème de communication) de l’asymétrie de l’interaction.
Actualité de novembre 2024
Soutenance de thèse

Description syntaxique des interrogatives partielles chez les enfants francophones : situation de diglossie ou exploitations différenciées d'une unique grammaire ?
Pauline Gillet
8 novembre 2024 | 14:00
Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | ATILF | Bâtiment CNRS | Salle Paul Imbs
Membres du jury
Directrice : Marie-Laurence Knittel (Maitre de Conférences HDR, Université de Lorraine)
Co-directeur : Christophe Benzitoun (Maitre de Conférences, Université de Lorraine)
Rapporteur : Ruggero Druetta (Professeur ordinaire, Université de Turin)
Rapporteure : Florence Lefeuvre (Professeure des Universités, Université Sorbonne Nouvelle)
Examinatrice : Julie Glikman (Professeure des Universités, Université de Lorraine)
Examinatrice : Katerina Palasis (Maitre de Conférences, Université Côte d’Azur)
Examinateur : Dan Van Raemdonck (Professeur des Universités, Université libre de Bruxelles)
Résumé de la thèse
Dans cette thèse, nous nous intéressons à la manière dont les enfants francophones s’approprient le système des interrogatives partielles directes (désormais IPD), particulièrement riche, du français. Effectivement, la langue française ne compte pas moins de dix tournures interrogatives en usage dans l’hexagone. D’un côté, on distingue les tournures conservant l’ordre sujet-verbe des phrases déclaratives du type comment il s’appelle ? ou bien il s’appelle comment ? Ces tournures, proscrites par l’Académie française et les manuels scolaires, sont pourtant les plus fréquentes à l’oral spontané ainsi que dans certains types d’écrits (SMS) chez les adultes francophones. De l’autre, on rencontre l’inversion sujet-verbe (comment s’appelle-t-il ?). Cette tournure possède un statut particulier en français : bien qu’enseignée à l’école comme étant la forme interrogative par excellence, elle demeure peu usitée dans la langue parlée par une large partie de la population et est minoritaire dans certaines productions écrites des adultes. Par ailleurs, certaines formes sont impossibles à réaliser (*quoi tu fais ?, *pourquoi part Jean ?) et d’autres sont très peu tolérées (?tu pars pourquoi ?, ?quand t’as dit ça ?). De fait, les mots interrogatifs sont soumis à diverses contraintes morphosyntaxiques, ce qui entraine des spécificités dans le fonctionnement des interrogatives en français. Ainsi, ce système étant hétérogène, on peut se demander comment les enfants s’approprient ces tournures entre norme, usages et contraintes grammaticales. Cette question constituera la première thématique de la présente thèse.
Ces tournures, selon qu’elles conservent ou non l’ordre sujet-verbe, ont un statut différent en français ce qui nous amène à nous questionner, dans un second temps, sur la manière de rendre compte de leur mode d’appropriation en tenant compte de l’input et de l’enseignement scolaire. Effectivement, nous défendons l’idée que les interrogatives avec inversion du sujet clitique (comment s’appelle-t-il ?) possèdent un statut grammatical spécifique différent de celles qui conservent l’ordre sujet-verbe comme comment il s’appelle ? et il s’appelle comment ? Et nous formulons également l’hypothèse que les mots interrogatifs ne fonctionnent pas de manière homogène. À cet égard, deux approches théoriques différentes peuvent être mises à l’épreuve des données et ainsi rendre compte de la variation : la théorie des savoirs grammaticaux de Blanche-Benveniste (1990) et l’approche diglossique de Ferguson (1959). À partir de ces deux modèles, nous proposons de réfléchir à l’articulation entre grammaire première/variété basse et grammaire seconde/variété haute en français.
Afin de répondre à ces deux questions de recherche, nous avons mené deux études sur corpus, la première à l’oral auprès d’enfants de 2-5 ans, la seconde à l’écrit chez des élèves de CE1-CM2. Nous avons aussi élaboré un test expérimental de productions orales que nous avons soumis à des élèves de moyenne section de maternelle et de CE1 dont nous avons également testé la compréhension de la tournure avec inversion du sujet clitique. Pour finir, nous avons soumis un questionnaire à des élèves de CM1-CM2 visant à évaluer leur représentation de la norme grammaticale de l’écrit. L’ensemble de ces sources de données nous permet d’étudier la distribution de diverses tournures dans des productions plus ou moins spontanées et en tenant compte du medium (oral/écrit) ainsi que du contexte (familial et/ou scolaire).
Actualité d'octobre 2024
Soutenance de thèse
Le Rôle de l'Apprentissage Statistique aux Tous-débuts de l'Apprentissage de la Lecture
Teng Guo
18 décembre 2023 | 09:00
Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | Bâtiment A | Salle A 104
Jury
Daniel Zagar, Directeur de thèse, Professeur, Université de Lorraine, Nancy, France
Bruno Rossion, Président du jury, Directeur de recherche, Centre National de la Recherche Scientifique & Université de Lorraine, Nancy, France
Davide Crepaldi, Rapporteur, Professeur, International School for Advanced Studies, Trieste, Italy
Xiuli Shelley Tong, Rapportrice, Professeure, University of Hongkong, Hongkong, China
Kathleen Rastle, Examinatrice, Professeure, Royal Holloway, University of London, Egham, United Kingdom
Résumé de la thèse
Basé sur une approche cognitive de la structure interne des systèmes d’écriture et sur la littérature existante sur l’enseignement explicite, l’apprentissage statistique (AS) et la théorie du pont syllabique, nous avons proposé un cadre théorique dans lequel un niveau d’unités associatives sert d’intermédiaire entre les représentations orthographiques et phonologiques. La recherche présentée dans cette thèse avait deux objectifs principaux : premièrement, examiner si l’apprentissage statistique, à ce niveau, permet aux pré-lecteurs d’extraire des régularités de correspondance graphème-phonème (CGP) dans l’apprentissage associatif lettre-syllabe, et deuxièmement, déterminer si la représentation phonologique est influencée par les connaissances orthographiques statistiques générées par les unités associatives. Pour répondre au premier objectif, les expériences 4.1 et 4.2 montrent que l’exposition des pré-lecteurs à une plus grande variété de régularités GPC intégrées dans les associations lettre-syllabe améliore leur conscience phonémique et la généralisation des syllabes non enseignées. Ces résultats confirment le rôle important de l’AS dans l’apprentissage des associations lettre-syllabe et dans l’acquisition du principe alphabétique aux tout débuts de l’apprentissage de la lecture. Répondant au deuxième objectif, les recherches menées dans les expériences 5.1 et 5.2 ont montré que les réponses des individus à une tâche phonologique sont influencées par des connaissances orthographiques statistiques, résultant de l’interaction entre orthographe et phonologie au travers d’un système cognitif d’unités associatives. Ces résultats éclairent les mécanismes d’acquisition précoce de la lecture, soulignant l’importance d’un enseignement explicite personnalisé et de l’AS dans le développement de la litéracie.
***************************************
« The Role of Statistical Learning at the Very Beginning of Learning to Read »
Thesis abstract
Based on a cognitive approach to the inner structure of writing systems and the existing literature on explicit instruction, statistical learning, and the syllabic bridge theory, we proposed a theoretical framework in which a level of associative units mediates between orthographic and phonological representations. The research presented in this thesis had two overarching aims: first, to examine whether statistical learning, at this level, allows prereaders to extract grapheme-phoneme correspondence (GPC) regularities in letters-to-syllable associative learning, and second, to determine whether phonological representation is influenced by statistical orthographic knowledge generated by associative units. To address the first aim, the research in Experiments 4.1 and 4.2 demonstrates that prereaders’ exposure to a greater variety of GPC regularities embedded in letters-to-syllable associations enhances their phonemic awareness and the generalisation of non-taught syllables. These findings suggest that the potential involvement of SL in learning letter-to-syllable associations might facilitate the acquisition of the alphabetic principle at the very beginning of learning to read. Addressing the second aim, the research in Experiments 5.1 and 5.2 showed that individuals’ responses to a phonological task are influenced by statistical orthographic knowledge, resulting from the interplay between orthography and phonology through associative units. These findings offer insights into early reading acquisition methods, underscoring the importance of tailored explicit instruction and SL in literacy development.
Actualité de décembre 2023
Soutenance de thèse
L’expérientiel d’une mobilité enseignante franco-allemande : quand binarité et complexité s’enchevêtrent
Chloé Provot
30 novembre 2023 | 14:00
Nancy | MSH Lorraine | 91 avenue de la Libération à Nancy | 3ᵉ étage | salle 324
Composition du jury
Mme Séverine Behra, Maîtresse de conférences, Université de Lorraine (examinatrice)
Mme Claire Demesmay, Chercheure associée HDR, Université de la Sarre (examinatrice)
Mme Anemone Geiger-Jaillet, Professeure des Universités, Université de Strasbourg (rapporteure)
Mme Greta Komur-Thilloy, Professeure des Universités, Université de Haute-Alsace (rapporteure)
Mme Dominique Macaire, Professeure des Universités émérite, Université de Lorraine (co-directrice)
M. Jean-Michel Pérez, Professeur des Universités, Université de Lorraine (examinateur)
Mme Claudia Polzin-Haumann, Professeure des Universités, Université de la Sarre (examinatrice)
Mme Julia Putsche, Maîtresse de conférences HDR, Université de Strasbourg (co-directrice)
Mots-clés
mobilité enseignante, franco-allemand, expérientiel, interculturel, identité, complexité
Résumé
Cette thèse en codirection porte sur un dispositif de mobilité enseignante franco-allemande, nommé Élysée Prim (coordonné par l’OFAJ, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse). Les enseignant·e·s du premier degré qui y participent partent en France ou en Allemagne pendant une voire plusieurs années enseigner l’allemand ou le français langue étrangère dans des écoles du premier degré. Notre recherche a pour objectif de répondre à l’interrogation suivante : comment les enseignant·e·s participant à la mobilité enseignante franco-allemande Élysée Prim perçoivent-ils/elles l’expérientiel de la mobilité, s’agissant des aspects interculturels, identitaires, langagiers, mais aussi de l’enseignement d’une langue étrangère au sein d’écoles élémentaires ? Plusieurs sous-questions découlent de notre question principale de recherche :
– Comment l’expérientiel de la mobilité enseignante franco-allemande Élysée Prim est-il perçu d’un point de vue interculturel par les enseignant·e·s participant·e·s ?
– Comment les enseignant·e·s participant à la mobilité Élysée Prim perçoivent-ils/elles leur identité personnelle ?
– Comment la mobilité enseignante franco-allemande Élysée Prim est-elle vécue d’un point de vue langagier par les enseignant·e·s participant·e·s ?
– Comment les enseignant·e·s participant·e·s perçoivent-ils/elles l’enseignement d’une langue étrangère dans le cadre de la mobilité enseignante franco-allemande Élysée Prim ?
La méthodologie de recherche utilisée est qualitative et se compose de l’observation d’une formation à laquelle participent les enseignant·e·s avant la mobilité et d’entretiens semi-directifs à visée compréhensive (Kaufmann, 2011) menés avec douze enseignantes (à parité égale entre Françaises et Allemandes) avant leur départ et après une année de mobilité, des représentant·e·s de l’OFAJ et de l’institution scolaire des deux pays. Les données ont été collectées durant l’année universitaire 2020-2021.
Actualité de novembre 2023
Soutenance de thèse
« 'Poétiques du récit de retour aux origines: du documentaire au roman' suivi de 'Je t'envoie des photos des primevères dans le sable' »
Marine Noël
17 novembre 2023 | 09:00
Pavillon Lionel-Groulx 3150, rue Jean-Brillant Montréal (Québec) CANADA H3T 1N8
Composition du jury
Mme Claire LEGENDRE | Université de Montréal | Directrice de thèse
Mme Véronique MONTéMONT | Université de Lorraine | Co-directrice de thèse
Mme Marie-Pascale HUGLO | Université de Montréal | Examinatrice
M. Matthieu FREYHEIT | Université de Lorraine | Examinateur
Mme Kiev RENAUD | Université de Sherbrooke | Rapporteure
M. Pierre-Louis FORT | Université Cergy-Paris | Rapporteur
Mots-clés
littérature, retour, transclasses, Raymond Depardon, ruralité, Annie Ernaux.
Résumé
Cette thèse porte sur le récit de retour aux origines dans la littérature contemporaine française et se concentre sur des auteurs transclasses, c’est-à-dire qui ont quitté leur milieu d’origine et changé de statut social. Elle s’intéresse spécifiquement à un corpus d’auteurs originaires de régions non attractives de l’Hexagone. Elle concentre son analyse sur des textes de Nicolas Mathieu, Annie Ernaux, Didier Eribon, Édouard Louis et Raymond Depardon. Ce travail détermine d’abord ce qui est entendu par « récit de retour » en littérature, notamment lorsqu’il s’agit de représenter les campagnes qui intéressent ces auteurs. Il dégage des poétiques du retour chez chacun de ces auteurs, en observant l’hybridité générique qui les traverse : la photobiographie et le documentaire avec Depardon, le roman avec Ernaux et Mathieu, l’autobiographie avec Louis, l’essai avec Eribon. Dans un second temps, la thèse examine la temporalité et la géographie du retour, en particulier les motifs de la nostalgie et du déplacement. La thèse explore ensuite le point de vue de l’auteur, narrateur ou personnage transclasse sur son milieu d’origine, point de vue tantôt décalé, renouvelé ou surplombant. À cette recherche succède un texte de création, Je t’envoie des photos des primevères dans le sable, qui allie, en deux temps, fiction et enquête photolittéraire et qui questionne lui aussi le geste de retour aux origines en milieu rural.
Actualité de novembre 2023
Soutenance de thèse
« Le lexique de l’environnement et ses termes liés à la chimie dans le discours ordinaire. Utilisation des réseaux sociaux comme corpus »
Tomara Gotkova
14 novembre 2023 | 09:00
Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | ATILF | Bâtiment CNRS | Salle Paul Imbs
Composition du jury
M. Alain POLGUERE | Université de Lorraine, CNRS, ATILF UMR 7118 | Directeur de thèse
Mme Rute COSTA | Universidade NOVA de Lisboa | Rapporteure
Mme Francesca INGROSSO | Université de Lorraine, CNRS, LPCT UMR 7019 | Co-directrice de thèse
M. Patrick DROUIN | Université de Montréal | Rapporteur
M. Mathieu CONSTANT | Université de Lorraine, CNRS, ATILF UMR 7118 | Examinateur
Mme Lucie BARQUE | Université Paris Diderot-Paris 7 | Examinatrice
Mots-clés
vocabulaire spécialisé, réseaux sociaux comme corpus, lexicographie informatisée, réseau lexical, Environnement, chimie.
Résumé
L’objectif principal de notre recherche interdisciplinaire est l’étude du vocabulaire de l’environnement au sein du discours ordinaire dans le contexte des enjeux environnementaux actuels et émergents. Tout d’abord, nous présentons un aperçu sociologique du débat environnemental et du rôle du grand public dans l’atténuation du changement climatique. Ensuite, nous formalisons notre conception de la terminologie liée aux enjeux environnementaux actuels et émergents et établissons une liste du vocabulaire de l’environnement pertinent. Pour cela, nous combinons des techniques de traitement automatique des langues avec une sélection manuelle. En intégrant l’approche du traitement automatique des langues à l’étude de la terminologie, nous comparons les notions de mot-clé et de Terme. Les mots-clés représentent des formes linguistiques sémantiquement ambiguës utilisées pour construire des corpus de discussions environnementales publiques extraits de deux réseaux sociaux : Twitter et Reddit. Inversement, les Termes sont des unités lexicales spécialisées et sémantiquement désambiguïsées. En outre, nous présentons une analyse approfondie du mot emblématique dans le domaine de l’environnement, carbon (Fr. carbone), ainsi que des Termes associés. Cette analyse repose sur deux aspects interreliés : (i) une étude linguistique de carbon dans le discours spécialisé ; (ii) une description lexicographique détaillée de carbon et des locutions liées. Les résultats révèlent la complexité de la terminologie autour de carbon et soulignent la nécessité de standardisation. Pour explorer la compréhension publique de carbon, nous examinons les données issues des corpus de réseaux sociaux. Nous nous concentrons sur les interprétations non terminologiques de carbon, par opposition à son usage dans le discours spécialisé, à travers le prisme de la domestication des Termes par la langue générale. Dans cette optique, nous proposons une nouvelle typologie des unités spécialisées en fonction de leur sémantisme et du registre de langue auquel elles appartiennent. Finalement, nous formulons une liste des recommandations terminologiques visant à traiter les défis actuels de la terminologie environnementale et sa communication au grand public.
Actualité d'octobre 2023
Soutenance de thèse
« Systèmes linguistiques en contact dans le chansonnier estense. Étude stratigraphique et philologique des éléments en langue d'oc et en langue d'oïl »
Barbara Francioni
30 mai 2023 | 14:30
Italy | Siena | Via Roma 56 | Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature antiche e moderne, Palazzo San Niccolò | Salle : Aula riunioni (416) || ou lien de connexion : https://meet.google.com/kax-runt-krt
Composition du jury
M. Yan Greub, Université de Lorraine, Directeur de thèse
Mme Nadine HENRARD, Université de Liège, Rapporteure
M. Riccardo VIEL, Università degli Studi di Bari, Rapporteur
M. Fabrizio CIGNI, Università di Pisa, Directeur de thèse
Mots-clés
Linguistique, Ancien Français, Troubadours, Provençal, Chansonniers, Trouvères
Résumé
Le travail a pour origine l’intention d’étudier la langue des troubadours à partir d’un point de vue différent : non celui de la recherche de la langue de l’auteur ou de l’étude de la scripta spécifique d’un témoin manuscrit, mais plutôt celui d’une tentative de combiner ces deux approches. Si la langue des auteurs se trouve analysée principalement dans les sections introductives des éditions critiques et dans quelques études dédiées surtout aux troubadours des premières générations, les études scriptologiques font généralement l’objet de chapitres séparés dans les études sur les différents chansonniers, sans qu’on parvienne toujours à faire communiquer les deux pistes de recherche : les études scriptologiques se concentrent premièrement sur ce qu’on peut définir comme la « langue des copistes », en partant d’une perspective horizontale, due à la nature même de l’étude linguistique qu’on peut mener sur ce type d’objet de recherche ; les éditions critiques offrent un regard plus vertical, sans toutefois prendre dûment en compte les possibles habitudes de plume et les éventuels tics des copistes, qui ne peuvent apparaître que sous la loupe d’une étude générale sur les différents témoins. C’est justement à la croisée des deux méthodes que cette thèse trouve son point de départ, sans prétendre à la solution définitive des problèmes intrinsèques qu’une étude linguistique sur les troubadours continue de poser, même quand l’on essaie d’aborder le sujet d’une manière « tridimensionnelle ». Nous avons, par conséquent, cherché à analyser l’objet de la recherche d’un point de vue stratigraphique, de façon à permettre d’apprécier l’écart entre la forme du texte au moment de sa production et la forme du texte au moment de sa réception manuscrite, en passant par le moment clé de la reproduction et de la performance orale et chantée des productions lyriques des troubadours. L’objet linguistique particulier de cette étude a été le rapport entre les deux variétés galloromanes de la France médiévale ; nous avons choisi de conjuguer les objectifs d’une étude linguistique de ce genre avec les nécessités d’une recherche sur la langue des troubadours, tout en tenant compte des ambiguïtés que cela implique. Une recherche ayant pour but d’étudier la langue des troubadours en fonction de ses rapports avec la langue d’oïl, avec l’ampleur et l’ambiguïté inhérentes que le caractère matériel du corpus à analyser entraîne, oblige à resserrer son champ d’application sur un objet d’analyse bien défini et délimité. C’est pour cette raison que nous avons décidé de concentrer notre attention non sur un seul troubadour ou sur un choix de poètes en langue d’oc particulièrement connus pour avoir noué de riches liens avec la partie Nord des domaines galloromans, mais sur un objet très concret, qui permet d’étudier l’influence du système linguistique d’oïl sur la langue des troubadours. Parmi les chansonniers qui contiennent des recueils de lyrique d’oc, il n’y en a que trois qui contiennent aussi des recueils bien organisés et matériellement distincts de lyrique d’oïl : étant donné que les deux manuscrits Wpr/Mfr et Xpr/Ufr sont en premier lieu des recueils lyriques en langue d’oïl et que les pièces occitanes qui y sont contenues ont déjà été étudiées, nous avons décidé d’analyser le « chansonnier estense », qui est le seul à avoir prévu deux sections séparées de lyrique en langue d’oc suivies par une section de lyrique en langue d’oïl, sections déjà prévues dans la structuration à l’origine de l’œuvre et annoncée dans les tables des incipit.
Actualité de mai 2023
Soutenance de thèse
« diagnostic computationnel du syndrome de shwachman-Diamond par des investigations cognitives et dialogiques »
Arthur Trognon
20 décembre 2022 | 14:30
Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | ATILF | Bâtiment CNRS | Salle Paul Imbs
Composition du jury
Michel MUSIOL, Université de Lorraine, Directeur de thèse
Bernard PACHOUD, Université Paris Cité, Rapporteur
Auriac EMMANUÈLE, Université Clermont Auvergne, Rapporteure
Jean DONADIEU, Hôpital Armand Trousseau, Co-encadrant de thèse
Annie KUYUMCUYAN, Université de Strasbourg, Examinatrice
Résumé
La maladie de Shwachman-Diamond est une maladie autosomique récessive rare ayant un impact ubiquitaire sur la physiologie, la vie, et l’autonomie des individus, incluant des anomalies fonctionnelles et cognitives, menant à des difficultés académiques et sociales. De manière générale, la façon dont le système nerveux des individus porteurs du syndrome de Shwachman-Diamond a reçu une attention relativement faible en comparaison avec le très grand nombre d’études ayant investigué les caractéristiques physiologiques et biomoléculaires de cette condition clinique. Les objectifs de ce travail doctoral étaient multiples : premièrement, il visait à (i) caractériser l’impact de la mutation SBDS et du syndrome de Shwachman-Diamond sur les fonctions intellectuelles et cognitives ; et (ii) de développer une méthode de diagnostic différentiel permettant de discriminer le syndrome de Shwachman-Diamond des autres pathologies neurodéveloppementales. L’approche méthodologie adoptée à travers le projet reposait sur des analyses multidimensionnelles, tout d’abord dans l’évaluation psychométrique des fonctions cognitives sur les plans intellectuels, attentionnels-exécutifs et sociaux ; mais aussi à travers une évaluation écologique des compétences pragmatiques à l’aide d’un dispositif original et développé spécifiquement pour l’étude ; et également à travers une évaluation interactive intégrée par analyse algébrique à l’aide du modèle Topologique et Cinétique de Trognon (2TK), développé spécifiquement dans ce travail doctoral et appliqué à tous les matériaux verbaux ayant été observés pendant la thèse. L’originalité majeure de ce travail étant le développement d’outils computationnels et algébriques, notamment par machine-learning et deep-learning, et permettant de faire usage de toutes les données collectables dans le champ des sciences humaines et sociales et de la psychologie de manière combinée, afin de réaliser des prédictions cliniques ou pouvant servir d’outil dynamique d’aide au monitoring clinique ou à la décision ; et dont la force principale étant que tous les outils développés ont été testés préalablement sur du matériel issu d’archives ayant donné lieux à des publications, et permettant de vérifier que les outils développés permettent (i) d’accéder à la totalité des informations mises en évidence dans les travaux d’origine et (ii) offrent des cadres de lectures spécifiques au modèle 2TK et congruents avec les modèles dont il est issu ; avant même d’analyser les premières données originales de ce travail. Nos résultats suggèrent que le syndrome de Shwachman-Diamond impacte principalement les capacités intégratives de l’individu, avec notamment des difficultés d’intégration des indices locaux dans un contexte global et des difficultés sélectives dans la théorie de l’esprit de second-ordre. Plus spécifiquement, les études réalisées suggèrent que les individus porteurs du syndrome de Shwachman-Diamond montrent un profil dissocié, avec des fonctions cognitives élémentaires (mémoire de travail, vitesse de traitement de l’information, théorie de l’esprit de premier ordre) préservées ; en contraste avec les fonctions cognitives intégrées (raisonnement perceptif, théorie de l’esprit de second-ordre, compétences pragmatiques) altérées. Elles sont donc congruentes avec les données de la littérature neuroscientifique, qui suggère que les deux centres computationnels du système nerveux central, le cortex préfrontal et le cortex cingulaire antérieur, sont touchés dans la maladie de Shwachman-Diamond. Ainsi, ces résultats challengent la vision actuelle des patients Shwachman-Diamond, qui considérait le déficit intellectuel comme étant la caractéristique cognitive de la maladie. En effet, nous avons montré que seules les compétences intégratives permettaient de réaliser le diagnostic de la maladie de Shwachman-Diamond par des méthodes automatisées.
Actualité de décembre 2022
Soutenance de thèse
« Étude multilingue du lexique de la chimie à l’interface entre terminologie et langue générale »
Polina Mikhel
16 décembre 2022 | 09:00
Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | Bâtiment A | Salle A104
Composition du jury
Alain POLGUÈRE, Université de Lorraine, Directeur de thèse
Francesca INGROSSO, Université de Lorraine, Co-directrice de thèse
Éva BUCHI, Université de Lorraine, Examinatrice
Svetlana KRYLOSOVA, INALCO, CREE, Examinatrice
Béatrice DAILLE, Université de Nantes, Examinatrice
John HUMBLEY, Université de Paris, Rapporteur
Maria Teresa ZANOLA, Università Cattolica del Sacro Cuore (Catholic University of the Sacred Heart), Rapporteure
Résumé
Ce projet de recherche doctorale interdisciplinaire est motivé par un double constat : 1) les approches traditionnelles d’étude et de représentation des systèmes terminologiques scientifiques reposent essentiellement sur le recours à des modèles taxinomiques (ontologies informatiques fondées sur des hiérarchies de classes conceptuelles) ; 2) les études contemporaines sur l’organisation du lexique de langue générale (lexicologie, psycholinguistique, etc.) tendent à s’accorder sur un mode de structuration en réseaux lexicaux multidimensionnels et non taxinomiques. La recherche repose sur l’hypothèse que les terminologies scientifiques, puisqu’elles fonctionnent dans les textes en interaction avec le lexique de langue générale, doivent posséder une structure homomorphe avec celle du lexique général, avec lequel elles fusionnent au sein de la langue. Il s’agit, dans ce contexte, d’explorer l’interface entre langue générale et terminologies, à la frontière entre termes et non-termes.
Sur le plan théorique, la recherche vise, d’une part, à apporter une solution au problème de la modélisation formelle et rigoureuse de la multidimensionnalité inhérente à l’organisation des terminologies, c’est-à-dire le fait que les termes peuvent être appréhendés et les terminologies parcourues selon de multiples axes. D’autre part, et de façon liée, la recherche vise à rendre compte de l’interdépendance entre lexique de langue générale et lexique terminologique.
Sur le plan pratique, la thèse débouchera sur des modèles terminologiques multilingues de la chimie, en français, en anglais et en russe. Ces modèles, conçus pour évoluer et être enrichis sur le long terme, seront des outils exploitables par les scientifiques aussi bien que par les enseignants en chimie. La recherche est de ce fait destinée à avoir une résonance non seulement dans le domaine de la recherche en lexicologie et terminologie, mais aussi auprès de la communauté des chimistes.
Le projet se situe dans la thématique des études lexicales, qui sont au cœur du projet scientifique du laboratoire ATILF. Il présente l’originalité d’aborder le sujet du rapport entre terme et non-terme dans le cadre des travaux menés à l’ATILF sur les grands réseaux lexicaux. Une exploitation intensive sera faite des modèles lexicaux développés depuis plusieurs années au laboratoire. En retour, la recherche doctorale alimentera ces ressources en données sur les terminologies anglaises et françaises de la chimie.
polina.mikhel [at] atilf.fr
Actualité de décembre 2022
Soutenance de thèse
« Les prépositions d’inclusion en ancien et moyen français : analyse diachronique de EN, ENZ, DEDANS et DANS »
Claire Schlienger
27 juin 2022 | 14:30
Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | ATILF | Bâtiment CNRS | Salle Paul Imbs
Composition du jury
Sylvie BAZIN-TACCHELLA, Professeur, Université de Lorraine, Directrice de thèse
Anne CARLIER, Professeur, Sorbonne Université, Examinatrice
Bernard COMBETTES, Professeur émérite, Université de Lorraine, Examinateur
Benjamin FAGARD, Chargé de recherche, HDR, Lattice, Rapporteur
Sophie PRéVOST, Directrice de recherche CNRS, Lattice, Examinatrice
Denis VIGIER, Maître de conférence, HDR, Université Lumière Lyon II, Rapporteur
Résumé
La diachronie des prépositions est un sujet d’étude qui a engendré de nombreux travaux durant ces dix dernières années, tel que le projet PRESTO et son étude des prépositions françaises du 16e au 20e siècle. Les analyses des prépositions EN et DANS sont particulièrement riches pour cette période, néanmoins celles antérieures au 16e siècle, n’ont pas suscité le même engouement. De ce fait, plusieurs aspects diachroniques restent incertains tels que l’origine de DANS qui repose sur plusieurs théories, la spécialisation de EN avec un complément abstrait, et de manière générale, les emplois de ces prépositions dans l’ancienne langue.
Dans l’intention de répondre à ces questions et d’enrichir la diachronie des prépositions, nous réalisons une analyse diachronique des prépositions EN, ENZ, DEDANS et DANS exprimant l’inclusion. La notion d’inclusion est à prendre au sens large, regroupant les approches structuralistes et cognitivistes, soit au sens de « X se situe / est inclus dans Y ».
Afin de définir les emplois des prépositions d’inclusion dans l’ancienne langue, nous orientons notre travail sur trois axes de recherches : caractériser les préférences syntaxiques et sémantiques de EN, ENZ, DEDANS et DANS en ancien et moyen français, identifier les phénomènes majeurs dans la diachronie des prépositions tels que l’origine de DEDANS et DANS et les changements linguistiques qui ont conduit aux emplois modernes de EN et DANS, et enfin établir la chronologie des prépositions, avec une datation des évolutions, du latin au 16e siècle.
Grâce aux bases textuelles BFM de Lyon (2016 et 2019) et Frantext, riches en ouvrages médiévaux, nous disposons de matériaux suffisants pour une analyse diachronique représentative de la langue. Afin d’y parvenir, nous réalisons dans un premier temps une analyse synchronique selon deux découpages temporels : un par période (AF et MF) et un par siècle (du 12e au 16e siècle). Avec l’analyse distributionnelle et l’observation des concurrences, nous déterminons les emplois de chaque préposition, y compris les formes contractées de EN (el, es, ou). À partir de ces résultats synchroniques, nous pouvons relever les changements linguistiques à travers une approche diachronique. Les analyses contrastives mettront au jour les spécialisations d’emplois et les remplacements.
Cette étude permettra de découvrir que DEDANS est le pivot dans la transition de EN vers DANS, que la spécialisation de EN avec des compléments abstraits a lieu dès le moyen français et que DANS vient remplacer DEDANS dès son apparition.
Cette thèse est une contribution aux recherches diachroniques déjà réalisées. Les périodes d’ancien et moyen français, moins observées pour ces prépositions, sont enrichies par ce travail à travers l’apport de précisions sur les comportements et changements linguistiques opérant du 12e au 16e siècle, en particulier avec ENZ et DEDANS qui sont peu étudiés.
Actualité de juin 2022
Soutenance de thèse
Analyse morphologique des mots construits sur base de noms de personnalités politiques
Mathilde Huguin
3 décembre 2021 | 14:30
Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | ATILF | Bâtiment CNRS | Salle Paul Imbs
Composition du jury
Fiammetta NAMER, Prof., Université de Lorraine & ATILF, Directrice
Stéphanie LIGNON, MCF, Université de Lorraine & ATILF, Co-directrice
Georgette DAL, Prof., Université de Lille & STL, Rapporteure
Richard HUYGHE, Prof., Université de Fribourg, Rapporteur
Vincent BALNAT, MCF HDR, Université de Strasbourg & LILPA, Examinateur
Marie-Laurence KNITTEL, MCF HDR, Université de Lorraine & ATILF, Examinatrice
Jean-Louis VAXELAIRE, Prof., Université de Namur & NaLTT, Examinateur
Titre : « Analyse morphologique des mots construits sur base de noms de personnalités politiques »
Résumé
Cette thèse décrit le comportement morphologique de l’anthroponyme, nom propre référant à un être humain, en tant que base de construction morphologique. Pour ce faire, nous analysons des désanthroponymiques spécifiques : les dérivés morphologiquement construits sur des noms propres de personnalités politiques françaises contemporaines (e.g. François Fillon > fillonophobie). Nous nous appuyons sur un corpus d’environ 6 500 formes construites et travaillons dans une démarche extensive, à partir de données contextualisées (50 000 contextes différents) issues de la Toile. Nous réalisons l’analyse morphologique de chaque désanthroponymique, qui est ensuite enregistrée dans la base de données MONOPOLI (Mots construits sur Noms propres de personnalités Politiques). Par rapport au lexique institutionnalisé standard, les désanthroponymiques de MONOPOLI sont originaux. Ils traduisent le plus souvent les avis de leurs inventeurs vis-à-vis des personnalités politiques. Ces locuteurs créent dans ce but des formes que l’on peut qualifier d’occasionnalismes. L’examen de chaque procédé morphologique permettant d’obtenir un désanthroponymique de MoNoPoli reflète cette originalité, révélant des modes de formation très variés, du plus régulier (e.g. Emmanuel Macron > macronisme) au plus atypique (e.g. Marine Le Pen > marinose). Notre analyse montre que l’anthroponyme ne correspond pas aux définitions des unités manipulées en morphologie, qu’il s’agisse du morphème ou du lexème. En effet, l’anthroponyme réunit un ensemble d’unités lexicales dénommées polyonymes (comportant, a minima, le prénom, le nom de famille et le nom complet) qui partagent une catégorie syntaxique et une composante sémantique bipartite constituée d’un sens dénominatif instructionnel et d’un sens stéréotypique. Comme les unités manipulées en morphologie sont insuffisantes pour rendre compte de l’anthroponyme et de ses dimensions, aucun modèle de la morphologie n’a les propriétés requises pour décrire le lexique qui en dérive. Cela a pour conséquence que les conditions de formation des unités du lexique général ne sont pas (entièrement) applicables au lexique désanthroponymique : la forme d’un dérivé de nom propre de personnalité politique est conditionnée non seulement par des contraintes formelles ou lexicales, mais aussi et surtout par des facteurs discursifs, pragmatiques et référentiels. Notre analyse apporte un éclairage nouveau aux mécanismes en dérivation, à la définition linguistique de l’anthroponyme et vient plus largement questionner les unités et modèles manipulés par la morphologie.
Title : “Morphological analysis of words based on names of political figures”
Abstract
This thesis describes the morphological behavior of anthroponyms—i.e., proper names referring to human beings—as bases of morphological construction. We analyze specific deanthroponyms which are words morphologically based on the proper names of contemporary French political figures (e.g., François Fillon > fillonophobe ‘fillonophobic’). We rely on a corpus of about 6,500 complex words (50,000 different contexts) from the Web. We perform the morphological analysis of each deanthroponym, which is then recorded in the database MONOPOLI (‘Mots construits sur noms propres de Personnalité Politique `words based on politician proper names’). Compared to the standard institutionalized lexicon, MONOPOLI’s deanthroponyms are original. They usually reflect the opinions of their inventors about political figures. For this purpose, these speakers create forms that can be described as nonce formations. Examining the morphological constructions listed in MONOPOLI reflects this originality and reveals a wealth of processes, from the most regular (e.g., Emmanuel Macron > macronisme ‘macronism’) to more atypical (e.g., Marine Le Pen > marinite ‘marinitis’). Our analysis shows that the anthroponym does not correspond to the definitions of the units manipulated in morphology, morpheme or lexeme. Anthroponyms bring together a set of lexical units called sub-names (at least the first name, the last name and the full name) which share a syntactic category and a bipartite semantic component comprising a denominative instructional meaning and a stereotypic meaning. Since the units manipulated in morphology are insufficient to account for the anthroponym and its dimensions, no model of morphology has the properties required to describe the deanthroponymic lexicon. This entails that the conditions of formation of the units of the general lexicon are not (entirely) applicable to the deanthroponymic lexicon: the form of a derivative of a political figure’s proper name is conditioned not only by formal or lexical constraints, but also and above all by discursive, pragmatic and referential factors. Our analysis sheds new light on the mechanisms in derivation, on the linguistic definition of the anthroponym and more broadly questions the units and models used in morphology.
Actualité de novembre 2021
Soutenance de thèse
Obstacles et facilitateurs à l’inclusion scolaire des élèves allophones dans l’enseignement secondaire en France et incidences didactiques
Julie Prevost
26 novembre 2021 | 14:00
Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | Bâtiment A | Salle A104
Composition du jury
Dominique MACAIRE, Université de Lorraine, Directrice de thèse
Jean-Pierre CUQ, Université Côte d’Azur, Examinateur
Jean-Michel PEREZ, Université de Lorraine, Examinateur
Séverine BEHRA, Université de Lorraine, Examinatrice
Maïtena ARMAGNAGUE ROUCHER, Université de Genève, Rapporteure
Fatima CHNANE DAVIN, Aix Marseille Université, Rapporteure
Résumé
Notre recherche porte sur l’inclusion scolaire d’élèves dits « allophones » en cours ordinaires dans le secondaire public en France. Ces élèves – migrants et ne parlant pas encore la langue de scolarisation – sont ainsi nommés par l’institution scolaire. De type qualitatif, l’étude repose sur l’analyse d’un corpus quinquangulaire (travaux, questionnaires, entretiens d’élèves, écrits autobiographiques, bulletins scolaires) recueilli auprès de 33 apprenants et de 6 enseignants (Académie de Nancy-Metz). Cette étude éclaire la situation métropolitaine. La problématique allophone relève d’une agrégation de multiples facteurs. Nous étudions des facilitateurs et des obstacles à l’inclusion scolaire des élèves allophones par l’étude des discours des élèves et des démarches didactiques des enseignants participant à notre recherche. Nos questions de chercheure se sont imposées en lien avec notre expérienciel professionnel et nos lectures. Trois hypothèses de recherche y sont subordonnées. D’abord, le contexte socio-économique familial n’est pas le seul obstacle à la réussite scolaire des élèves allophones suivis. Ensuite, l’affiliation en cours disciplinaire de français des élèves allophones suivis permet un apprentissage mieux maitrisé du FLSco. Enfin, l’inclusion en cours disciplinaire de français permet aux élèves allophones suivis d’investir davantage l’école. Il ressort de cette étude que les apprenants suivis partagent un contexte socio-économique fragile et que la composition familiale et la taille de la fratrie distinguent les élèves suivis. Toutefois, ces éléments n’apparaissent pas comme des facteurs freinants en soi la réussite scolaire. Si la majorité est en difficulté, certains apprenants suivis réussissent à l’école. Cependant, les disparités langagières perdurent sur l’année, voire se creusent. L’expression d’un projet scolaire n’est pas interdépendante de leur affiliation en classe régulière, elle est plutôt liée à leurs origines culturelles. Les démarches didactiques des enseignants participant à notre recherche sont hétérogènes. Elles dépendent de ressources intellectuelles et contextualisées. Les enseignants ne sont pas toujours sensibles aux particularismes culturels de leurs élèves – ce qui peut desservir les élèves suivis – parce qu’ils n’y sont pas assez formés. Cette étude montre que le modèle de la formation initiale et continue des enseignants devrait évoluer, en lien plus étroit avec la recherche. En dépit d’un cadrage national, les aménagements spécifiques pour la scolarisation des élèves allophones varient sur le plan académique, voire départemental. Cela se traduit, sur le terrain, par des inégalités scolaires. Dans notre corpus, il apparait que les ressources mobilisées par les élèves et leurs enseignants sont hétérogènes. Ainsi, l’environnement scolaire est l’un des facilitateurs à l’inclusion et à la réussite scolaire. Apparait également une distorsion entre les prescriptions institutionnelles et la réalité des terrains qui s’explique par le dilemme auquel fait face l’institution scolaire. Cette dernière doit donner toute sa place à la langue française mais également offrir un espace à l’identité des apprenants issus de la diversité. La gestion verticale de la problématique allophone, sa mise en œuvre – complexifiée par le grand nombre de partenaires – et un état de la recherche-formation insuffisant déséquilibrent les conditions de scolarisation des allophones. La question allophone nécessiterait d’être considérée de manière holistique.
Actualité de novembre 2021