Allô j’écoute ! Sortir du silence … Les lignes d’écoute et vous : appel à témoins (Appelant & écoutant)
Vous avez plus de 18 ans, vous avez déjà fait appel à un dispositif d’écoute (SOS Amitié, Suicide Ecoute, NightLine France etc.), nous avons besoin de vous ! Nous vous invitons à participer anonymement à ce programme de science participative qui vise à mieux comprendre l’utilisation des lignes d’écoute.
À l’occasion de la journée mondiale 2025 de la santé qui se déroule lundi 7 avril 2025, nous sommes allés à la rencontre de Gudrun Ledegen, enseignante-chercheure, pour mieux comprendre ses travaux de recherche.
Gudrun Ledegen est professeure des universités à l’Université Rennes 2, spécialisée en sociolinguistique – analyse de discours. Elle est membre du laboratoire PREFICS (Pôle de Recherche et de Formation Information, Communication, Sociolinguistique), une unité de recherche interdisciplinaire à vocation internationale réunissant sciences de l’information et de la communication et sciences du langage (sociolinguistique et analyse de discours). Les travaux qui y sont menés visent à saisir les dynamiques langagières et communicationnelles, par ex. dans l’argumentation (controverses, monde politique …), ou encore la place du langagier dans le « smart power ».
Gudrun Ledegen est aussi chercheure associée au LLL (Laboratoire ligérien de linguistique), un laboratoire de recherche du CNRS, des universités d’Orléans, de Tours et de la BNF. Tout particulièrement dans les axes de recherche portant sur les corpus oraux et la francophonie, comme sur les interactions sensibles.
Gudrun Ledegen est accueillie au laboratoire (public) de recherche ATILF, du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Durant cette période pour sa recherche, elle est rattachée à l’axe de recherche De la syntaxe au discours codirigé par Mathilde Dargnat et Christophe Benzitoun.
Depuis son étude doctorale en 1998, elle explore les dynamiques linguistiques, autour du français en Belgique tout d’abord, à La Réunion par la suite, et la Zone Océan Indien, puis plus largement les francophonies, pour poser des parallèles entre les différents français ‘ordinaires’ pratiqués de par le monde, en particulier sur le plan de la variation syntaxique : ses explorations se centrent par exemple autour de l’interrogative indirecte in situ (tu sais c’est quoi les règles de jeux ?), qu’elle étudie depuis ses toutes premières années en tant que maîtresse de conférences à La Réunion, où la structure est toute ordinaire.
Sa mission à l’ATILF est d’explorer le fonds Claire Blanche-Benveniste (1935-2010), linguiste française qui se situe au centre de documentation Michel Dinet à l’ATILF.
Son objectif est d’étudier l’argumentation ordinaire : Claire Blanche-Benveniste avait en effet commencé à explorer ce phénomène dans le cadre de l’approche macro-syntaxique, en se situant à l’intersection des recherches syntaxiques sur le français parlé et de l’analyse de discours.
[Définition] Macrosyntaxe – Par exemple, quand on dit :
Il pleut, donc je mets pas mes sandales.
- Comme il pleut, je mets pas mes sandales.
- Il pleut, je mets pas mes sandales.
Les 3 phrases disent le même lien, les 2 premières explicitant le lien entre les 2 portions à l’aide de donc ou comme (ce qu’on va appeler hypotaxe), la 3ᵉ non (appelée parataxe, ‘juxtaposition’). Cette dernière forme, plutôt attestée à l’oral, est plus difficile à identifier dans un écrit qui est globalement plutôt formel (cf. plus bas).
Cette étude se concrétisera sur un corpus d’écrit électronique novateur, non étudié à ce jour, lequel se révèle fortement argumentatif : un corpus de 11 ans de chat (tchat) de prévention du suicide, objet d’étude au sein de l’ANR SAPS (Sciences avec et pour la société), intitulé APIPréSui (Analyse participative et interdisciplinaire d’un chat de prévention du suicide), qu’elle coordonne scientifiquement.
Le laboratoire PREFICS mène depuis plus de 10 ans des recherches sur l’utilisation des dispositifs d’aide (SOS Amitié, Suicide Ecoute, etc.) ; dans un premier temps au sein des sciences de l’information et de la communication et depuis 2018, par les sciences du langage. Aujourd’hui soutenue par l’ANR, l’équipe lance un large appel à témoignages. Gudrun Ledegen, enseignante-chercheure en sciences du langage, nous détaille ce projet de grande ampleur destiné à améliorer ces services.
L’entretien avec Gudrun Ledegen
« En quoi consiste ce projet ANR dédié aux lignes d’écoute ? »
Gudrun Ledegen : À savoir, depuis une vingtaine d’années, les lignes d’écoute, classiquement téléphoniques, sont passées au numérique, sur le chat et le mail, avec l’avènement du numérique dans nos vies quotidiennes. La multiplication des possibilités de prise de contact permet à de nouveaux publics de trouver une oreille attentive auprès des écoutants bénévoles. Mais dit-on la même chose à l’aide de la voix ou par l’écrit numérique ? À quels publics ces différents dispositifs s’adressent-ils ? Comment fonctionnent-ils ?
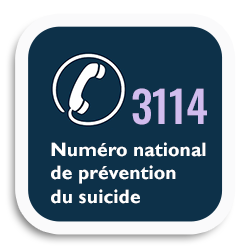 Nous nous intéressons aux interactions entre les personnes qui contactent des dispositifs d’aide tels que SOS Amitié, Suicide Ecoute, Nightline France ou autre, et les personnes qui leur répondent. Et plus précisément aux mots, le principal “matériel” utilisé dans ce contexte : après un premier volet en communication, nous abordons ces interactions avec une approche sociolinguistique et d’analyse du discours. Nous cherchons à comprendre comment fonctionne le dispositif, comment l’écoutant accueille l’appelant ? Comment la personne se confie-t-elle ?
Nous nous intéressons aux interactions entre les personnes qui contactent des dispositifs d’aide tels que SOS Amitié, Suicide Ecoute, Nightline France ou autre, et les personnes qui leur répondent. Et plus précisément aux mots, le principal “matériel” utilisé dans ce contexte : après un premier volet en communication, nous abordons ces interactions avec une approche sociolinguistique et d’analyse du discours. Nous cherchons à comprendre comment fonctionne le dispositif, comment l’écoutant accueille l’appelant ? Comment la personne se confie-t-elle ?
Les recherches menées en sciences du langage s’attachent à comprendre le rôle des différents types de formulation dans la relation d’aide des lignes d’écoute. Comment permettent-ils l’expression de la souffrance, et quelle forme de souffrance permettent-ils de soulager ? Quels publics accueillent-ils ? Ces recherches repèrent les éléments langagiers qui bâtissent cette relation d’aide particulière, pour mieux la comprendre et participer à l’amélioration de cette prise en charge. Par exemple, la violence verbale que les appelants expriment contre eux-mêmes est systématiquement contre-argumentée de façon remarquable par les écoutants pour contrer ces discours qui blessent.
Par ailleurs, nous analysons les différents registres utilisés qui vont d’une langue de la distance, avec 90% des ne de négations maintenus, un vouvoiement quasi généralisé, à une langue de la proximité, pour parler des sujets sensibles, où les appelants expriment des émotions fortes par le choix des mots (de façon exceptionnelle, les termes peuvent être familiers ou grossiers, auquel cas ils sont accompagnés d’excuses et des marques de politesse, ou signalés par des guillemets, pour éviter d’offenser l’écoutant en ligne).
Nous cherchons aussi à mieux cerner pourquoi une personne va privilégier le téléphone, le mail ou le tchat. Ainsi, le tchat est un mode de communication qui se déroule en direct mais par écrit et à distance ; il présente une série de caractéristiques qui le rendent particulièrement attractifs pour la jeune génération dans cette situation d’interaction sensible. Écrire, le plus souvent, rassure, et permet de franchir le pas : « J’hésitais à appeler donc finalement j’ai écrit », confie un utilisateur. Parfois, les appelants s’affirment incapables d’évoquer leur souffrance oralement. Certains racontent même transmettre leurs discussions écrites à leurs proches quand ils sont sur le chemin du mieux aller, afin de partager avec eux ces moments si difficiles qu’ils n’ont pas pu formuler.
« Qui peut participer à votre programme de science participative ? »
GL : Toute personne de plus de 18 ans qui a fait l’expérience par le passé d’une sollicitation d’une ligne d’écoute. L’idée n’est pas du tout de poser des questions intrusives sur leurs soucis ou difficultés, mais simplement de comprendre pourquoi elles et ils se sont tournés vers un dispositif de ce type, quel médium ou moyen ils ont privilégié (téléphone, tchat ou mail), et de décrire la façon dont cela s’est déroulé.
Il y a quatre modalités* de participation qui sont offertes au public (*au choix ou plusieurs options sont possibles)
1. Soit via un entretien d’environ une heure (en présentiel ou en distanciel)
2. Soit via un témoignage écrit
3. Une enquête
4. Un mur virtuel de gratitude
Dans tous les cas, l’anonymat et la confidentialité sont pleinement garantis : les données transmises par mail servent à recontacter les appelant s’ils le souhaitent pour convenir d’un rendez-vous pour un entretien ; les témoignages écrits, comme les informations données dans l’enquête ou sur le mur virtuel, sont anonymisés et les adresses mail ne sont absolument pas conservées.
Pour une présentation plus longue du projet en question, Gudrun Ledegen est joignable : gudrun.ledegen [at] univ-rennes2.fr.
Lire la note sur la RGPD* | Règlement général sur la protection des données.
« Quels sont les objectifs du projet ? »
GL : Nous bénéficions d’un financement ANR SAPS** | Science avec et pour la société, qui implique une phase de rencontre avec les associations et les bénéficiaires. L’objectif, c’est donc de mettre en lumière la pertinence du travail de ces bénévoles, qui permet d’éviter des actes très graves. Et plus largement, de casser les stéréotypes sur la santé mentale, qu’aller voir un·e psy signifie être fou ou folle, ou qu’appeler une ligne d’écoute est un aveu d’impuissance.
Comme le souligne un appelant : « Je ne suis pas un cassos ! »
L’un des buts est aussi d’améliorer leurs services, en présentant nos recherches dans la formation d’écoute des bénévoles, par exemple. Ou encore d’améliorer la représentation attachée aux lignes d’écoute, en éclairant leur fonctionnement, ce qui peut donner un horizon d’attente clair aux appelants, même si le taux de déception ou mécontentement est très bas (ces derniers cas sont inclus dans nos analyses). Et enfin, de permettre aux utilisateurs de part et d’autre, appelants comme écoutants, de s’exprimer, pour remercier, pour expliciter leur besoin de solliciter ou d’aider …
« Vous menez des recherches depuis plusieurs années sur ce sujet. Quels sont les principaux enseignements de vos travaux avec votre regard de 2025 ? »
GL : Nous attestons que ce dispositif a une vraie utilité, en complément d’autres aides, notamment de professionnel·les de la santé mentale. Les personnes qui contactent ces lignes ne peuvent pas toujours se confier auprès de leur entourage, ni d’un psychologue disponible sur rendez-vous et non aux heures nocturnes ; ainsi, le dispositif fait office de sas, parce qu’il permet une écoute “sans lendemain” par une personne, qui ne porte pas de jugement. Le fait d’exposer sa situation à quelqu’un d’inconnu, qui écoute attentivement, aide à mettre les éléments davantage à distance. L’appelant doit expliciter sa situation à l’écoutant qui ne connait rien du contexte.
Nos recherches ont aussi montré que via le tchat ou le mail, les tournures trop formelles fonctionnent moins bien, car l’écrit instaure déjà de la distance dans l’interaction. Mieux vaut donc privilégier des formules moins recherchées.
Un appelant estime qu’ : « Il faudrait leur donner le prix Nobel de la présence et de l’écoute ! »
Nous attestons aussi des petits bijoux de gestion d’une émotion négative par un ou une écoutante, qui va réussir, grâce à l’identification d’une émotion positive, à amener l’humour dans la conversation : souvent, dans ce bref moment, la personne qui appelle arrive à se confier, à mettre des mots précis sur son mal-être et à terminer la conversation en se sentant mieux – ce type de “technique” pourrait servir d’exemple et être utilisé par d’autres.
Nous avons remarqué par ailleurs que les jeunes préfèrent le chat, car ils et elles considèrent la conversation téléphonique comme “trop réelle” : le tchat est comme un sas de sécurité dans lequel on expose moins ses émotions portées par la voix. À l’inverse, pour les personnes plus âgées, le monde de l’écrit équivaut surtout à un registre formel, distant : ils disent parfois avoir du mal à y exprimer leurs émotions.
« Ça me fait tenir la marée » Citation d’un extrait d’un entretien qui démontre comment la ligne d’écoute aide un appelant à tenir entre calme et tempêtes …
|
APPEL À PARTICIPATION
Vous avez plus de 18 ans, 4 possibilités vous sont offertes : 1. Vous, appelants comme écoutants, pouvez participer à un entretien d’environ une heure (en présentiel ou en distanciel) | Contact : prefics-lignes-ecoute [at] univ-rennes2.fr À SAVOIR : dans tous les cas, l’anonymat et la confidentialité sont pleinement garantis : les données transmises par mail servent à recontacter les personnes si elles le souhaitent pour convenir d’un rendez-vous pour un entretien ; les témoignages écrits, comme les informations données dans l’enquête ou sur le mur virtuel, sont anonymisés et les adresses mail ne sont absolument pas conservées. |
Mots clés : ATILF, santé mentale, suicide, prévention santé, sociolinguistique, lignes d’écoute, mel, téléphone, tchat
Quelques chiffres
La DREES | Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques publie le 6ᵉ rapport de l’Observatoire national du suicide. Ce rapport synthétise les grandes tendances des conduites suicidaires en France ainsi que leurs facteurs structurants, tout en soulignant les apports et limites de chaque indicateur. Ces résultats contribuent à éclairer la réflexion sur les mesures de prévention.
Le taux de suicide des personnes de 85-94 ans est de 35,2 pour 100 000, près du triple du taux mesuré pour l’ensemble de la population. Avec 9 200 décès par suicide recensés en 2022, le taux de suicide atteint 13,3 décès pour 100 000 habitants, un niveau trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes (20,8 et 6,3 pour 100 000, respectivement).
Chez les jeunes, le suicide constitue la deuxième cause de mortalité […]. [Si] les jeunes femmes demeurent la population chez qui le taux de suicide est le plus faible, bien qu’il ait augmenté de près de 40 % entre 2020 et 2022 […], [leur mal-être va croissant].
Aller plus loin
Lire l’article Suicide, mal-être : plongée au cœur d’un chat de prévention publié sur le site TCF | The conversation France le 26 janvier 2022.
Lire l’article Les lignes d’écoute et vous : partagez votre expérience publié sur le site de l’Université de Rennes 2 le 12 novembre 2024 – modifié le 9 janvier 2025.
Consulter le site Hypothèse.
Écouter le chanteur Stromae qui a témoigné, par son titre L’enfer, de sa propre expérience des pensées suicidaires, suite à son burn-out, au cours d’une prestation largement commentée | dimanche 9 janvier 2022, au 20h de TF1.
Télécharger l’affiche Sortir du silence… Les lignes d’écoute et vous
* [Source : wikipédia] RGPD | Règlement général sur la protection des données, officiellement appelé règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, est un règlement de l’Union européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l’Union européenne
** [Source : ANR] Financement ANR | Agence nationale de la recherche SAPS : Projet-ANR-23-SSRP-0004 | https://anr.fr/Projet-ANR-23-SSRP-0004
.
