Journée d’études
Mettre la langue en tables
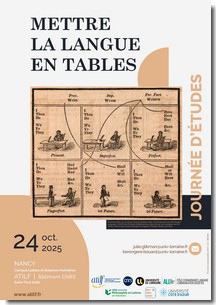 Date : 24 octobre 2025
Date : 24 octobre 2025Lieu : Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | ATILF | Bâtiment CNRS | Salle Paul Imbs
Visioconférence : Lien à venir
Organisation : Bérengère Bouard (ATILF), Julie Glikman (ATILF), Cendrine Pagani-Naudet (BCL), Nicolas Mazziotta (UR Traverses).
Soutien : ATILF (CNRS & Université de Lorraine) | UFR ALL (Université de Lorraine) | CLCS (Université de Lorraine) | BCL (Université Cote d’azur) | UR Traverses (Université de Liège) | Département de linguistique synchronique du français (Université de Liège)
Contacts : julie.glikman [at] univ-lorraine.fr | berengere.bouard [at] univ-lorraine.fr
Visualiser le programme
Cette journée d’études a pour objectif d’amorcer une réflexion collective sur une forme du discours linguistique : les tableaux ou tables, objet dans lequel on peut reconnaître une des formes les plus anciennes de diagrammes (Bigg 2016).
Les représentations organisées des connaissances sous forme de listes et de tableaux sont observables dès les premières grammaires imprimées. La table reste aujourd’hui une entrée récurrente en didactique (on pensera par exemple aux tableaux de conjugaison type Bescherelle). D’une manière générale, l’importance des diagrammes en linguistique (Stewart 1976 ; Roggenbuck 2005 ; Bubenhofer 2020 ; Mazziotta, François, et Kahane 2024) justifie qu’on s’interroge sur la façon dont ils sont construits et sur leur utilisation concrète, notamment d’un point de vue historique, angle d’analyse encore peu exploré.
Cette journée d’études se propose de réunir des spécialistes du domaine de l’histoire des grammaires et des représentations diagrammatiques. Notre perspective alliera histoire des théories linguistiques et analyses sémiotiques et discursives.
Les discussions pourront porter sur les points suivants.
1. Qu’est-ce qu’un tableau ? une table ? La question se pose d’un point de vue sémiotique et terminologique.
– À quoi reconnait-on une table ? Quelles sont les caractéristiques visuelles de ces objets (Groupe µ 1992) ? Quelles propriétés structurelles sont mises en œuvre pour organiser la pensée grammaticale et la réduire à un espace bidimensionnel ? D’un point de vue historique, on pourra également mettre en rapport le perfectionnement matériel de ces tableaux (disposition du texte, typographie, délimitation, lignes, espaces, hiérarchisation par variation typographique, usage de signes particuliers) et l’histoire du livre.
– Qu’appelons-nous tables ? Qu’est-ce qui les distingue d’une liste, d’un index, ou encore d’un arbre ? L’emploi même du mot est un indice des attentes de ceux qui font usage de ces objets, de la manière dont les auteurs envisagent leur propre pratique. Ainsi ce que les grammairiens du XVIᵉ siècle désignaient par le mot table ne répond pas toujours aux attentes de l’usager contemporain, qu’il s’agisse de ses marques formelles ou de ses fonctionnalités. Si les tables sont des diagrammes spécifiques, quelles sont les propriétés qui les distinguent des autres diagrammes (listes, index, arbres) et comment ces propriétés s’articulent-elles à la description de la langue ?
2. Qu’est-ce qui est mis en table ? Quelles données linguistiques sont présentées de manière privilégiée sous forme de tableaux (et inversement quelles sont celles qui ne le sont jamais) ? Quelle évolution observe-t-on de ce point de vue ? Comment se répartissent expression textuelle, présentation en tableau et les autres formes diagrammatiques qui se développent plus tardivement, et selon quelles modalités (concurrence ou complémentarité) ?
3. Comment tableau et texte sont-ils mis en relation ? Le tableau permet-il de redire autrement ce qui a fait l’objet d’un discours développé ? Constitue-t-il plutôt un discours qui permet de régler une difficulté conceptuelle ? Dans les cas où le texte est pratiquement absent, cela signifie-t-il que l’exposition des données mises en table peut suffire ? Faut-il au contraire recomposer un contexte pédagogique qui supplée l’absence de texte ?
4. Quelle est la visée des tableaux ? « Simple » support didactique ou expression formalisée de la connaissance grammaticale ? Qu’est-ce qui distingue ou, au contraire, rapproche les tableaux que l’on trouve dans les grammaires, des autres formes de modélisation conçues à des fins descriptives et spéculatives ? Dans quelle mesure se manifeste à travers cet objet la distinction entre savoir savant et savoir enseigné (Chevallard [1985] 1991) et celle, plus spécifique, entre grammaire scolaire, grammaire générale et linguistique ?
Bernard Colombat (Laboratoire Histoire des théories linguistiques, UMR 7597, Paris)
Nicolas Grevov (Université de Liège, UR Traverses)
Richard Hudson (University College London, Angleterre)
Aimée Lahaussois (Laboratoire Histoire des théories linguistiques, UMR 7597, Paris)
Nicolas Mazziotta (U. Liège, Belgique)
Cendrine Pagani-Naudet (UMR 7320 BCL/Université Côte d’Azur)
Sophie Piron (UQAM, Canada)
Pierre Swiggers (U. Liège/Louvain, Belgique) & Elizaveta Zimont (U. Reims Champagne Ardenne)
Bigg, Charlotte. 2016. « Diagrams ». In A Companion to the History of Science, édité par Bernard Lightman, 1re éd., 557 71. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118620762.ch39.
Bubenhofer, Noah. 2020. Visuelle Linguistik: zur Genese, Funktion und Kategorisierung von Diagrammen in der Sprachwissenschaft. Linguistik – impulse & tendenzen 90. Berlin: De Gruyter.
Campbell-Kelly, Martin, et Mary Croarken, éd. 2007. The History of Mathematical Tables: From Sumer to Spreadsheets. Reprint. Oxford: Oxford Univ. Press.
Chevallard, Yves. (1985) 1991. La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné. Grenoble: Pensée sauvage.
Groupe µ, éd. 1992. Traité du signe visuel: pour une rhétorique de l’image. La Couleur des idées. Paris: Seuil.
Klinkenberg, Jean-Marie. 2008. « La relation entre le texte et l’image. Essai de grammaire générale ». Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques 19 (1): 21 79. https://doi.org/10.3406/barb.2008.23906.
Mazziotta, Nicolas, Jacques François, et Sylvain Kahane. 2024. « Des outils graphiques pour étudier le langage et les langues. Les diagrammes en linguistique »: Travaux de linguistique n° 87 (2): 7 28. https://doi.org/10.3917/tl.087.0007.
Roggenbuck, Simone. 2005. Die Wiederkehr der Bilder: Arboreszenz und Raster in der interdisziplinären Geschichte der Sprachwissenschaft. Tübingen: G. Narr.
Stewart, Ann Harleman. 1976. Graphic representation of models in linguistic theory. Bloomington: Indiana University Press.
Nancy | Campus Lettres et Sciences Humaines | ATILF | Bâtiment CNRS | Salle Paul Imbs
Liens utiles
Collectivités
Mairie de Nancy
Métropole du Grand Nancy
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
Région Grand-Est
Accès et transports
Venir à Nancy : en train, en voiture, en avion, par voie fluviale, en bus.
Se déplacer sur le territoire : transports urbains, locations de voitures, taxis, se déplacer à vélo.
Transports publics : plan général du réseau Stan
Tourisme
Office de Tourisme
Séjourner à Nancy
Se restaurer à Nancy
Patrimoine et culture